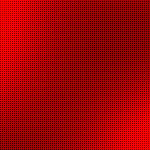mon adolescence assez inutilement, lecteur, si est-ce que par je ne
sçay quelle naturelle inclination j’ay tousjours aimé les bonnes
lettres: singulierement nostre poësie françoise, pour m’estre plus
familiere, qui vivoy’ entre ignorans des langues estrangeres. Depuis,
la raison m’a confirmé en cete opinion: considerant que si je vouloy’
gaingner quelque nom entre les Grecz, et Latins, il y fauldroit
employer le reste de ma vie, et (peult estre) en vain, etant jà coulé
de mon aage le temps le plus apte à l’etude: et me trouvant chargé
d’affaires domestiques, dont le soing est assez suffisant pour dégouter
un homme beaucoup plus studieux que moy.
Au moyen de quoy, n’ayant où passer le temps, et ne voulant du tout le perdre, je me suis volontiers appliqué à nostre poësie: excité et de mon propre naturel, et par l’exemple de plusieurs gentiz espritz françois, mesmes de ma profession, qui ne dedaignent point manier et l’epée et la plume, contre la faulse persuasion de ceux qui pensent tel exercice de lettres deroger à l’estat de noblesse. Certainement, lecteur, je ne pouroy’ et ne voudroy’ nier, que si j’eusse ecrit en grec ou en latin, ce ne m’eust esté un moyen plus expedié pour aquerir quelque degré entre les doctes hommes de ce royaume: mais il fault que je confesse ce que dict Ciceron en l’oraison pour Murene, Qui cùm cytharoedi esse non possent, et ce qui s’ensuit. Considerant encores nostre langue estre bien loing de sa perfection, qui me donnoit espoir de pouvoir avecques mediocre labeur y gaingner quelque ranc, si non entre les premiers, pour le moins entre les seconds, je voulu bien y faire quelque essay de ce peu d’esprit que la Nature m’a donné. Voulant donques enrichir nostre vulgaire d’une nouvelle, ou plustost ancienne renouvelée poësie, je m’adonnay à l’immitation des anciens Latins, et des poëtes Italiens, dont j’ay entendu ce que m’en a peu apprendre la communication familiere de mes amis. Ce fut pourquoy, à la persuasion de Jaques Peletier, je choisi le Sonnet et l’Ode, deux poëmes de ce temps là (c’est depuis quatre ans) encores peu usitez entre les nostres: étant le Sonnet d’italien devenu françois, comme je croy, par Mellin de Sainct Gelais, et l’Ode, quand à son vray et naturel stile, representée en nostre langue par Pierre de Ronsard. Ce que je vien de dire, je l’ay dict encores en quelque autre lieu, s’il m’en souvient: et te l’ay bien voulu ramentevoir, lecteur, afin que tu ne penses que je me vueille attribuer les inventions d’autruy. Or, afin que je retourne à mon premier propos, voulant satisfaire à l’instante requeste de mes plus familiers amis, je m’osay bien avanturer de mettre en lumiere mes petites poësies: après toutesfois les avoir communiquées à ceux que je pensoy’ bien estre clervoyans en telles choses, singulierement à Pierre de Ronsard, qui m’y donna plus grande hardiesse que tous les autres, pour la bonne opinion que j’ay tousjours eue de son vif esprit, exact sçavoir, et solide jugement en nostre poësie françoise. Je n’ay pas icy entrepris de respondre à ceux qui me voudroient blasmer d’avoir precipité l’edition de mes oeuvres, et, comme on dict, avoir trop tost mis la plume au vent. Car si mes ecriz sont bons, ma jeunesse ne leur doibt oster leur louange meritée. S’ilz ne sont tels, elle doibt pour le moins leur servir d’excuse: d’aultant que si j’ay faict en cet endroit quelque acte de jeunesse, je n’ay faict si non ce que je devoy’. Pour le moins, ce m’est une faulte commune avecques beaucoup d’autres meilleurs espriz que le mien. Je ne suis tel, que je vueille blâmer le conseil d’Horace, quand à l’edition des poëmes: mais aussi ne suis-je de l’opinion de ceux qui gardent religieusement leurs ecriz, comme sainctes reliques, pour estre publiez apres leur mort: sçachant bien que tout ainsi que les mors ne mordent point, aussi se sentent-ilz les morsures. Cete conscientieuse difficulté, lecteur, n’estoit ce qui me retardoit le plus en la premiere edition de mes ecriz. Je craignoy’ un autre inconvenient, qui me sembloit avoir beaucoup plus apparente raison de future reprehension. C’est que telle nouveauté de poësie pour le commencement seroit trouvée fort etrange, et rude. Au moyen de quoy, voulant prevenir cete mauvaise opinion, et quasi comme applanir le chemin à ceux qui, excitez par mon petit labeur, voudroient enrichir nostre vulgaire de figures et locutions estrangeres, je mis en lumiere ma Deffence et illustration de la langue françoise: ne pensant toutefois au commencement faire plus grand oeuvre qu’une epistre et petit advertissement au lecteur. Or ay-je depuis experimenté ce qu’au paravant j’avoy assez preveu, c’est que d’un tel oeuvre je ne rapporteroy jamais favorable jugement de noz rethoriqueurs françoys, tant pour les raisons assez nouvelles, et paradoxes introduites par moy en nostre vulgaire, que pour avoir (ce semble) hurté un peu trop rudement à la porte de noz ineptes rimasseurs. Ce que j’ay faict, lecteur, non pour aultre raison que pour eveiller le trop long sillence des cignes et endormir l’importun croassement des corbeaux. Ne t’esbahis donques si je ne respons à ceulx qui m’ont apellé hardy repreneur: car mon intention ne feut onques d’auctorizer mes petiz oeuvres par la reprehension de telz gallans. Si j’ay particularizé quelques ecriz, sans toutefois toucher aux noms de leurs aucteurs, la juste douleur m’y a contrainct, voyant nostre langue, quand à sa nayfve proprieté si copieuse, et belle, estre souillée de tant de barbares poësies, qui par je ne scay quel nostre malheur plaisent communement plus aux oreilles françoises que les ecritz d’antique, et solide erudition. Les gentilz espris, mesmes ceulx qui suyvent la court, seule escolle ou voluntiers on apprent à bien proprement parler, devroient vouloir pour l’enrichissement de nostre langue, et pour l’honneur des espriz françois, que telz poëtes barbares, ou feussent fouettez à la cuysine, juste punition de ceulx qui abusent de la pacience des Princes, et grands Seigneurs par la lecture de leurs ineptes oeuvres: ou (si on les vouloit plus doucement traicter) qu’on leur donnast argent pour se taire; suyvant l’exemple du grand Alexandre, qui usa de semblable liberalité en l’endroict de Cherille, poëte ignorant. Certes j’ay grand’honte, quand je voy’ le peu d’estime que font les Italiens de nostre poësie en comparaison de la leur: et ne le treuve beaucoup etrange, quand je considere que voluntiers ceulx qui ecrivent en la langue Toscane sont tous personnaiges de grand’ erudition: voire jusques aux Cardinaux mesmes et aultres seigneurs de renom, qui daignent bien prendre la peine d’enrichir leur vulgaire par infinité de beaux ecriz: usant en cela de la diligence et discretion familiere à ceulx qui legerement n’exposent leurs conceptions au publique jugement des hommes. Pense donques, je te prie, Lecteur, quel prix doivent avoir, en l’endroict de celle tant docte et ingenieuse nation Italienne, les ecriz d’ung petit Magister, d’un Conard, d’un Badault, et aultres mignons de telle farine, dont les oreilles de nostre peuple sont si abbreuvées, qu’elles ne veulent aujourd’huy recevoir aultre chose. Je suis certain que tous lecteurs de bon jugement prendront ce que je dy en bonne part, veu que je ne parle du tout sans raison. Au fort, si nos petiz Rimeurs s’en trouvoint un peu fachez, je leur conseilleroy’ de prendre pacience: considerant que je ne suis ung Aristarque ou Aristophane, dont la grave censure doive oster leurs ecriz du rôle de noz poësies, ou retarder leurs aucteurs de mieux faire à l’advenir. Aussi leur mescontentement ne me doit rompre ma deliberation, qui par veu solennel me suis obligé aux Muses de ne mentir jamais (que je le puisse entendre) ni en vin ni en poësie. Toutefois je ne veux pas du tout estre juge si severe, et incorruptible en matiere de poësie, que je suyve l’heresie de celuy qui disoit Mitte me in lapicidinas. Quelques uns se plaignent de quoy je blâme les traductions poëtiques en nostre langue, dont ilz ne sont (disent-ilz) illustrateurs ny gaigez ny renommez. Aussi ne suis-je. Mais s’ilz n’alleguent aultre raison, je n’y feray point de response. Encores moins à ce qu’ilz disent, que j’ay reservé la lecture de mes ecriz à une affectée demy-douzaine des plus renommez poëtes de nostre langue. Car je n’avoy’ entrepris de faire un catalogue de tous les autres, mesmes de ceulx qui ne m’etoient conneuz ny à leurs noms ny à leurs oeuvres. Ceux dont je ne cherche point les applaudissements ont occasion de gronder. Aussi me plaisent leurs aboys: car je n’en crain’ gueres les morsures. Je fonde encor’ (disent-ilz) l’immortalité de mon nom sur moindre chose que leurs escritz, dont toutefois ilz ne pretendent aucune louange. Ce n’est à eulx ny à moy à juger de nostre cause: qui (Dieu mercy) n’est de telle importance, que la court y doibve estre longuement embesongnée. Aussi n’ay-je pas fondé mon advancement sur telles magnifiques comparaisons. Si en mes poësies je me loüe quelques fois, ce n’est sans l’imitation des anciens: et en cela je ne pense avoir encor’ esté si excessif, que j’aye, pour illustrer le mien, offensé l’honneur de personne. Et puis je me vante d’avoir inventé ce que j’ay mot à mot traduit les aultres. A peu que je ne leur fay la responce que fist Virgile à un quiddam Zoile, qui le reprenoit d’emprunter les vers d’Homere. J’ay (ce me semble) ailleurs assez deffendu l’immitation. C’est pourquoy je ne feray longue response à cet article. Qui vouldroit à ceste ballance examiner les escritz des anciens Romains et des modernes Italiens, leurs arrachant toutes ces belles plumes empruntées dont ilz volent si haultement, ilz seroint en hazard d’estre accoutrez en corneille Horacienne. Si, par la lecture des bons livres, je me suis imprimé quelques traictz en la fantaisie, qui après, venant à exposer mes petites conceptions selon les occasions qui m’en sont données, me coulent beaucoup plus facilement en la plume qu’ilz ne me reviennent en la memoire, doibt-on pour ceste raison les appeller pieces rapportées? Encor’ diray-je bien que ceulx qui ont leu les oeuvres de Virgile, d’Ovide, d’Horace, de Petrarque, et beaucoup d’aultres, que j’ay leuz quelquefois assez negligemment, trouverront qu’en mes escriptz y a beaucoup plus de naturelle invention que d’artificelle ou supersticieuse immitation. Quelques ungs voyans que je finissoy’ ou m’efforçoy’ de finir mes sonnetz par ceste grace qu’entre les aultres langues s’est faict propre l’epigramme françois, diligence qu’on peult facilement recongnoistre aux oeuvres de Cassola Italien, disent pour ceste raison que je l’ay immité, bien que de ce temps là il ne me feust congneu seulement de nom, ou Apollon jamais ne me soit en ayde. Je ne me suis beaucoup travaillé en mes ecriz de ressembler aultre que moymesmes: et si en quelque endroict j’ay usurpé quelques figures et façons de parler à l’imitation des estrangers, aussi n’avoit aucun loy ou privilege de le me deffendre. Je dy encores cecy, Lecteur, affin que tu ne penses que j’aye rien emprunté des nostres, si d’avanture tu venois à rencontrer quelques epithetes, quelques phrases et figures prises des anciens, et appropriées à l’usaige de nostre vulgaire. Si deux peintres s’efforcent de representer au naturel quelque vyf protraict, il est impossible qu’ilz ne se rencontrent en mesmes traictz et lineamens, ayans mesme exemplaire devant eulx. Combien voit-on entre les Latins immitateurs des Grecz, entre les modernes Italiens immitateurs des Latins, de commencemens et de fins de vers, de couleurs, et figures poëtiques quasi semblables? Je ne parle poinct des orateurs. Ceulx qui voudront considerer le stile des Ciceroniens, ou aultres, ne trouverront estrange la ressemblance qu’ont ou pourront avoir les poëmes françois, si chacun s’efforce d’escrire par immitation des estrangers. Tous arts et sciences ont leurs termes naturelz. Tous mestiers ont leurs propres outilz. Toutes langues ont leurs motz et loqutions usitées: et qui n’en voudroit user, il se faudroit forger à part nouveaux artz, nouveaulx mestiers et nouvelles langues. Ce que j’ay dict, cetuy ci l’a dict encor’, et cetuy là: aussi les Muses n’ont restrainct, et enfermé en l’esprit de deux ou trois tout ce qui se peut dire de bonne grace en nostre poësie. S’il y a quelques faultes en mes escritz, aussi ne sont tous les aultres parfaictz. Ceulx qui avecques raison me voudront faire ce bien de me reprendre, je mettray peine d’en faire mon profit. Car je ne suis du nombre de ceulx qui ayment myeux deffendre leurs faultes que les corriger. Mais si quelques ungs directement ou indirectement (comme on dict) me vouloient taxer, non point avecques la raison et modestie accoutumée en toutes honnestes controversies de lettres, mais seulement avecques une petite maniere d’irrision et contournement de nez, je les adverty’ qu’ilz n’attendent aulcune response de moy: car je ne veux pas faire tant d’honneur à telles bestes masquées, que je les estime seulement dignes de ma cholere. Si quelques uns vouloient renouveler la farce de Marot et de Sagon, je ne suis pour les en empescher: mais il fault qu’ilz cherchent aultre badin pour jouer ce rôle avecques eux. Voylà ung petit desseing lecteur, de ce que je pouroy’ bien respondre à mes calomniateurs, si je vouloy’ prendre la peine de leur tenir plus long propoz. Quand à ceux qui blasment en moy cet etude poëtique, comme totalement inutile, s’ilz veulent combatre contre la poësie, elle a des armes pour se deffendre: s’ilz plaignent l’empeschement de ma promotion, je les remercie de leur bonne volunté. Ceux qui ayment le jeu, les banquetz et aultres menuz plaisirs, qu’ilz y passent et le jour; et la nuict si bon leur semble. Quand à moy, n’ayant aultre passetems de plus grand plaisir, je donneray vouluntiers quelques heures à la poësie. Et combien ce m’est un labeur peu laborieux, et coutumier, si ce n’est ou faisant quelque voiage ou en lieu qui n’ait aultre plus joyeuse occupation, bien l’entendent ceux qui me hantent de familiarité. J’ayme la poësie, me tire bien souvent la Muse (comme dict quelqu’un) furtivement en son oeuvre: mais je n’y suis tant affecté, que facilement je ne m’en retire, si la fortune me veult presenter quelque chose, ou avecques plus grand fruict je puisse occuper mon esprit. Je te prie donques, amy Lecteur, me faire ce bien de penser que ma petite muse, telle qu’elle est, n’est toutefois esclave ou mercenaire, comme d’ung tas de rymeurs à gaiges: elle est serve tant seulement de mon plaisir. Je te prie encores ne trouver mauvais cet advertissement, ou t’ennuyer de sa longueur, comme oultrepassant les bornes d’une epistre. En recompence de quoy, je te fay’ present de mon Olive augmentée de plus de la moitié, et d’une Musagnoeomachie, c’est à dire la Guerre des Muses et de l’Ignorance. Ceux qui ne treuvent rien bon, si non ce qui sort de leur main, y trouverront à mordre en beaucoup de lieux: mesme en cet endroict ou je fay mention de quelques sçavans hommes de nostre France. Les uns diront que j’en ay laissé que je ne devoy’ pas oublier: les aultres, que je n’ay pas gardé l’ordre, nommant quelques ungs les derniers, qui meritoient bien estre au premier ranc. Je n’ay qu’une petite response à toutes ces objections frivoles: c’est que mon intention n’estoit alors d’ecrire une hystoire, mais une poësie. Et combien ce genre d’escrire est peu consciencieux en telles choses, je m’en rapporte seulement à ceux qui l’entendent. Mais pourquoy pren-je tant de peine, lecteur, à preoccuper l’excuse de ce qui sera trouvé (peult estre) la moindre faulte de mes oeuvres? J’ay tousjours estimé la poësie comme ung somptueux banquet, ou chacun est le bien venu, et n’y force lon personne de manger d’une viande ou boire d’un vin, s’il n’est à son goust, qui le sera (possible) à celuy d’un aultre. C’est encor’ la raison pourquoy j’ay si peu curieusement regardé à l’orthographie, la voyant au jourdhuy aussi diverse qu’il y a de sortes d’ecrivains. J’appreuve et loue grandement les raisons de ceux qui l’ont voulu reformer, mais voyant que telle nouveaulté desplaist autant aux doctes comme aux indoctes, j’ayme beaucoup mieulx louer leur invention que de la suyvre: pource que je ne fay pas imprimer mes oeuvres en intention qu’ilz servent de cornetz aux apothequaires, ou qu’on les employe à quelque aultre plus vil mestier. Si tu treuves quelques faultes en l’impression, tu ne t’en dois prendre à moy, qui m’en suis rapporté à la foy d’autruy. Puis le labeur de la correction est tel, singulierement en un oeuvre nouveau, que tous les yeux d’Argus ne fourniroient à voir les faultes qui s’i treuvent.
 Cultivons nous
Cultivons nous