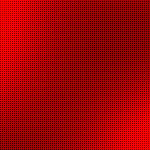Les Caractères Des Grands
La prévention du peuple en faveur des grands est si aveugle, et l’entêtement pour leur geste, leur visage, leur ton de voix et leurs manières si général, que, s’ils s’avisaient d’être bons, cela irait à l’idolâtrie.
Si vous êtes né vicieux, ô Théagène, je vous plains; si vous le devenez par faiblesse pour ceux qui ont intérêt que vous le soyez, qui ont juré entre eux de vous corrompre, et qui se vantent déjà de pouvoir y réussir, souffrez que je vous méprise. Mais si vous êtes sage, tempérant, modeste, civil, généreux, reconnaissant, laborieux, d’un rang d’ailleurs et d’une naissance à donner des exemples plutôt qu’à les prendre d’autrui, et à faire les règles plutôt qu’à les recevoir, convenez avec cette sorte de gens de suivre par complaisance leurs dérèglements, leurs vices et leur folie, quand ils auront, par la déférence qu’ils vous doivent, exercé toutes les vertus que vous chérissez: ironie forte, mais utile, très propre à mettre vos mœurs en sûreté, à renverser tous leurs projets, et à les jeter dans le parti de continuer d’être ce qu’ils sont, et de vous laisser tel que vous êtes.
L’avantage des grands sur les autres hommes est immense par un endroit: je leur cède leur bonne chère, leurs riches ameublements, leurs chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs nains, leurs fous et leurs flatteurs; mais je leur envie le bonheur d’avoir à leur service des gens qui les égalent par le cœur et par l’esprit, et qui les passent quelquefois.
Les grands se piquent d’ouvrir une allée dans une forêt, de soutenir des terres par de longues murailles, de dorer des plafonds, de faire venir dix pouces d’eau, de meubler une orangerie; mais de rendre un cœur content, de combler une âme de joie, de prévenir d’extrêmes besoins ou d’y remédier, leur curiosité ne s’étend point jusque-là.
On demande si en comparant ensemble les différentes conditions des hommes, leurs peines, leurs avantages, on n’y remarquerait pas un mélange ou une espèce de compensation de bien et de mal, qui établirait entre elles l’égalité, ou qui ferait du moins que l’un ne serait guère plus désirable que l’autre. Celui qui est puissant, riche, et à qui il ne manque rien, peut former cette question; mais il faut que ce soit un homme pauvre qui la décide.
Il ne laisse pas d’y avoir comme un charme attaché à chacune des différentes conditions, et qui y demeure jusques à ce que la misère l’en ait ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l’excès, et les petits aiment la modération; ceux-là ont le goût de dominer et de commander, et ceux-ci sentent du plaisir et même de la vanité à les servir et à leur obéir; les grands sont entourés, salués, respectés; les petits entourent, saluent, se prosternent; et tous sont contents.
Il coûte si peu aux grands à ne donner que des paroles, et leur condition les dispense si fort de tenir les belles promesses qu’ils vous ont faites, que c’est modestie à eux de ne promettre pas encore plus largement.
” Il est vieux et usé, dit un grand; il s’est crevé à me suivre: qu’en faire ? ” Un autre, plus jeune, enlève ses espérances, et obtient le poste qu’on ne refuse à ce malheureux que parce qu’il l’a trop mérité.
” Je ne sais, dites-vous avec un air froid et dédaigneux, Philante a du mérite, de l’esprit, de l’agrément, de l’exactitude sur son devoir, de la fidélité et de l’attachement pour son maître, et il en est médiocrement considéré; il ne plaît pas, il n’est pas goûté. ” — Expliquez-vous: est-ce Philanthe, ou le grand qu’il sert, que vous condamnez ?
Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s’en plaindre.
Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le gros lot, ou quelques autres la faveur des grands ?
Les grands sont si heureux, qu’ils n’essuient pas même, dans toute leur vie, l’inconvénient de regretter la perte de leurs meilleurs serviteurs, ou des personnes illustres dans leur genre, et dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus d’utilité. La première chose que la flatterie sait faire, après la mort de ces hommes uniques, et qui ne se réparent point, est de leur supposer des endroits faibles, dont elle prétend que ceux qui leur succèdent sont très exempts: elle assure que l’un, avec toute la capacité et toutes les lumières de l’autre, dont il prend la place, n’en a point les défauts; et ce style sert aux princes à se consoler du grand et de l’excellent par le médiocre.
Les grands dédaignent les gens d’esprit qui n’ont que de l’esprit; les gens d’esprit méprisent les grands qui n’ont que de la grandeur. Les gens de bien plaignent les uns et les autres, qui ont ou de la grandeur ou de l’esprit, sans nulle vertu.
Quand je vois d’une part auprès des grands, à leur table, et quelquefois dans leur familiarité, de ces hommes alertes, empressés, intrigants, aventuriers, esprits dangereux et nuisibles, et que je considère d’autre part quelle peine ont les personnes de mérite à en approcher, je ne suis pas toujours disposé à croire que les méchants soient soufferts par intérêt, ou que les gens de bien soient regardés comme inutiles; je trouve plus mon compte à me confirmer dans cette pensée, que grandeur et discernement sont deux choses différentes, et l’amour pour la vertu et pour les vertueux une troisième chose.
Lucile aime mieux user sa vie à se faire supporter de quelques grands, que d’être réduit à vivre familièrement avec ses égaux.
La règle de voir de plus grands que soi doit avoir ses restrictions. Il faut quelquefois d’étranges talents pour la réduire en pratique.
Quelle est l’incurable maladie de Théophile ? Elle lui dure depuis plus de trente années, il ne guérit point: il a voulu, il veut, et il voudra gouverner les grands; la mort seule lui ôtera avec la vie cette soif d’empire et d’ascendant sur les esprits. Est-ce en lui zèle du prochain ? est-ce habitude ? est-ce une excessive opinion de soi-même ? Il n’y a point de palais où il ne s’insinue; ce n’est pas au milieu d’une chambre qu’il s’arrête: il passe à une embrasure ou au cabinet; on attend qu’il ait parlé, et longtemps et avec action, pour avoir audience, pour être vu. Il entre dans le secret des familles; il est de quelque chose dans tout ce qui leur arrive de triste ou d’avantageux; il prévient, il s’offre, il se fait de fête, il faut l’admettre. Ce n’est pas assez pour remplir son temps ou son ambition, que le soin de dix mille âmes dont il répond à Dieu comme de la sienne propre: il y en a d’un plus haut rang et d’une plus grande distinction dont il ne doit aucun compte, et dont il se charge plus volontiers. Il écoute, il veille sur tout ce qui peut servir de pâture à son esprit d’intrigue, de médiation et de manège. À peine un grand est-il débarqué, qu’il l’empoigne et s’en saisit; on entend plus tôt dire à Théophile qu’il le gouverne, qu’on n’a pu soupçonner qu’il pensait à le gouverner.
Une froideur ou une incivilité qui vient de ceux qui sont au-dessus de nous nous les fait haïr, mais un salut ou un sourire nous les réconcilie.
Il y a des hommes superbes, que l’élévation de leurs rivaux humilie et apprivoise; ils en viennent, par cette disgrâce, jusqu’à rendre le salut; mais le temps, qui adoucit toutes choses, les remet enfin dans leur naturel.
Le mépris que les grands ont pour le peuple les rend indifférents sur les flatteries ou sur les louanges qu’ils en reçoivent, et tempère leur vanité. De même les princes, loués sans fin et sans relâche des grands ou des courtisans, en seraient plus vains s’ils estimaient davantage ceux qui les louent.
Les grands croient être seuls parfaits, n’admettent qu’à peine dans les autres hommes la droiture d’esprit, l’habileté, la délicatesse, et s’emparent de ces riches talents comme de choses dues à leur naissance. C’est cependant en eux une erreur grossière de se nourrir de si fausses préventions: ce qu’il y a jamais eu de mieux pensé, de mieux dit, de mieux écrit, et peut-être d’une conduite plus délicate, ne nous est pas toujours venu de leur fonds. Ils ont de grands domaines, et une longue suite d’ancêtres: cela ne leur peut être contesté.
Avez-vous de l’esprit, de la grandeur, de l’habileté, du goût, du discernement ? en croirai-je la prévention et la flatterie, qui publient hardiment votre mérite ? Elles me sont suspectes, et je les récuse. Me laisserai-je éblouir par un air de capacité ou de hauteur qui vous met au-dessus de tout ce qui se fait, de ce qui se dit et de ce qui s’écrit; qui vous rend sec sur les louanges, et empêche qu’on ne puisse arracher de vous la moindre approbation ? Je conclus de là plus naturellement que vous avez de la faveur, du crédit et de grandes richesses. Quel moyen de vous définir, Téléphon ? on n’approche de vous que comme du feu, et dans une certaine distance, et il faudrait vous développer, vous manier, vous confronter avec vos pareils, pour porter de vous un jugement sain et raisonnable. Votre homme de confiance, qui est dans votre familiarité, dont vous prenez conseil, pour qui vous quittez Socrate et Aristide, avec qui vous riez, et qui rit plus haut que vous, Dave enfin, m’est très connu: serait-ce assez pour vous bien connaître ?
Il y en a de tels, que s’ils pouvaient connaître leurs subalternes et se connaître eux-mêmes, ils auraient honte de primer.
S’il y a peu d’excellents orateurs, y a-t-il bien des gens qui puissent les entendre ? S’il n’y a pas assez de bons écrivains, où sont ceux qui savent lire ? De même on s’est toujours plaint du petit nombre de personnes capables de conseiller les rois, et de les aider dans l’administration de leurs affaires; mais s’ils naissent enfin ces hommes habiles et intelligents, s’ils agissent selon leurs vues et leurs lumières sont-ils aimés, sont-ils estimés autant qu’ils le méritent ? Sont-ils loués de ce qu’ils pensent et de ce qu’ils font pour la patrie ? Ils vivent, il suffit: on les censure s’ils échouent, et on les envie s’ils réussissent. Blâmons le peuple où il serait ridicule de vouloir l’excuser. Son chagrin et sa jalousie, regardés des grands ou des puissants comme inévitables, les ont conduits insensiblement à le compter pour rien, et à négliger ses suffrages dans toutes leurs entreprises, à s’en faire même une règle de politique.
Les petits se haïssent les uns les autres lorsqu’ils se nuisent réciproquement. Les grands sont odieux aux petits par le mal qu’ils leur font, et par tout le bien qu’ils ne leur font pas: ils leur sont responsables de leur obscurité, de leur pauvreté et de leur infortune, ou du moins ils leur paraissent tels.
C’est déjà trop d’avoir avec le peuple une même religion et un même Dieu: quel moyen encore de s’appeler Pierre, Jean, Jacques, comme le marchand ou le laboureur ? Evitons d’avoir rien de commun avec la multitude; affectons au contraire toutes les distinctions qui nous en séparent. Qu’elle s’approprie les douze apôtres, leurs disciples, les premiers martyrs (telles gens, tels patrons); qu’elle voie avec plaisir revenir, toutes les années, ce jour particulier que chacun célèbre comme sa fête. Pour nous autres grands, ayons recours aux noms profanes; faisons-nous baptiser sous ceux d’Annibal, de César et de Pompée: c’étaient de grands hommes; sous celui de Lucrèce: c’était une illustre Romaine; sous ceux de Renaud, de Roger, d’Olivier et de Tancrède: c’étaient des paladins, et le roman n’a point de héros plus merveilleux; sous ceux d’Hector, d’Achille, d’Hercule, tous demi-dieux; sous ceux même de Phébus et de Diane; et qui nous empêchera de nous faire nommer Jupiter ou Mercure, ou Vénus, ou Adonis ?
Pendant que les grands négligent de rien connaître, je ne dis pas seulement aux intérêts des princes et aux affaires publiques, mais à leurs propres affaires; qu’ils ignorent l’économie et la science d’un père de famille, et qu’ils se louent eux-mêmes de cette ignorance; qu’ils se laissent appauvrir et maîtriser par des intendants; qu’ils se contentent d’être gourmets ou coteaux, d’aller chez Thaïs ou chez Phryné, de parler de la meute et de la vieille meute, de dire combien il y a de postes de Paris à Besançon, ou à Philisbourg, des citoyens s’instruisent du dedans et du dehors d’un royaume, étudient le gouvernement, deviennent fins et politiques, savent le fort et le faible de tout un État, songent à se mieux placer, se placent, s’élèvent, deviennent puissants, soulagent le prince d’une partie des soins publics. Les grands, qui les dédaignaient, les révèrent: heureux s’ils deviennent leurs gendres.
Si je compare ensemble les deux conditions des hommes les plus opposées, je veux dire les grands avec le peuple, ce dernier me paraît content du nécessaire, et les autres sont inquiets et pauvres avec le superflu. Un homme du peuple ne saurait faire aucun mal; un grand ne veut faire aucun bien, et est capable de grands maux. L’un ne se forme et ne s’exerce que dans les choses qui sont utiles; l’autre y joint les pernicieuses. Là se montrent ingénument la grossièreté et la franchise; ici se cache une sève maligne et corrompue sous l’écorce de la politesse. Le peuple n’a guère d’esprit, et les grands n’ont point d’âme: celui-là a un bon fond, et n’a point de dehors; ceux-ci n’ont que des dehors et qu’une simple superficie. Faut-il opter ? Je ne balance pas: je veux être peuple.
Quelque profonds que soient les grands de la cour, et quelque art qu’ils aient pour paraître ce qu’ils ne sont pas et pour ne point paraître ce qu’ils sont, ils ne peuvent cacher leur malignité, leur extrême pente à rire aux dépens d’autrui, et à jeter un ridicule souvent où il n’y en peut avoir. Ces beaux talents, se découvrent en eux du premier coup d’œil, admirables sans doute pour envelopper une dupe et rendre sot celui qui l’est déjà, mais encore plus propres à leur ôter tout le plaisir qu’ils pourraient tirer d’un homme d’esprit, qui saurait se tourner et se plier en mille manières agréables et réjouissantes, si le dangereux caractère du courtisan ne l’engageait pas à une fort grande retenue. Il lui oppose un caractère sérieux, dans lequel il se retranche; et il fait si bien que les railleurs, avec des intentions si mauvaises, manquent d’occasions de se jouer de lui.
Les aises de la vie, l’abondance, le calme d’une grande prospérité font que les princes ont de la joie de reste pour rire d’un nain, d’un singe, d’un imbécile et d’un mauvais conte: les gens moins heureux ne rient qu’à propos.
Un grand aime la Champagne, abhorre la Brie; il s’enivre de meilleur vin que l’homme du peuple: seule différence que la crapule laisse entre les conditions les plus disproportionnées, entre le seigneur et l’estafier.
Il semble d’abord qu’il entre dans les plaisirs des princes un peu de celui d’incommoder les autres. Mais non, les princes ressemblent aux hommes; ils songent à eux- mêmes, suivent leur goût, leurs passions, leur commodité: cela est naturel.
Il semble que la première règle des compagnies, des gens en place ou des puissants, est de donner à ceux qui dépendent d’eux pour le besoin de leurs affaires toutes les traverses qu’ils en peuvent craindre.
Si un grand a quelque degré de bonheur sur les autres hommes, je ne devine pas lequel, si ce n’est peut-être de se trouver souvent dans le pouvoir et dans l’occasion de faire plaisir; et si elle naît, cette conjoncture, il semble qu’il doive s’en servir. Si c’est en faveur d’un homme de bien, il doit appréhender qu’elle ne lui échappe; mais comme c’est en une chose juste, il doit prévenir la sollicitation, et n’être vu que pour être remercié; et si elle est facile, il ne doit pas même la lui faire valoir. S’il la lui refuse, je les plains tous deux.
Il y a des hommes nés inaccessibles, et ce sont précisément ceux de qui les autres ont besoin, de qui ils dépendent. Ils ne sont jamais que sur un pied; mobiles comme le mercure, ils pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ils s’agitent; semblables à ces figures de carton qui servent de montre à une fête publique, ils jettent feu et flamme, tonnent et foudroient: on n’en approche pas, jusqu’à ce que, venant à s’éteindre, ils tombent, et par leur chute deviennent traitables, mais inutiles.
Le suisse, le valet de chambre, l’homme de livrée, s’ils n’ont plus d’esprit que ne porte leur condition, ne jugent plus d’eux-mêmes par leur première bassesse, mais par l’élévation et la fortune des gens qu’ils servent, et mettent tous ceux qui entrent par leur porte, et montent leur escalier, indifféremment au-dessous d’eux et de leurs maîtres: tant il est vrai qu’on est destiné à souffrir des grands et de ce qui leur appartient.
Un homme en place doit aimer son prince, sa femme, ses enfants, et après eux les gens d’esprit; il les doit adopter, il doit s’en fournir et n’en jamais manquer. Il ne saurait payer, je ne dis pas de trop de pensions et de bienfaits, mais de trop de familiarité et de caresses, les secours et les services qu’il en tire, même sans le savoir. Quels petits bruits ne dissipent-ils pas ? quelles histoires ne réduisent-ils pas à la fable et à la fiction ? Ne savent-ils pas justifier les mauvais succès par les bonnes intentions, prouver la bonté d’un dessein et la justesse des mesures par le bonheur des événements, s’élever contre la malignité et l’envie pour accorder à de bonnes entreprises de meilleurs motifs, donner des explications favorables à des apparences qui étaient mauvaises, détourner les petits défauts, ne montrer que les vertus, et les mettre dans leur jour, semer en mille occasions des faits et des détails qui soient avantageux, et tourner le ris et la moquerie contre ceux qui oseraient en douter ou avancer des faits contraires ? Je sais que les grands ont pour maxime de laisser parler et de continuer d’agir; mais je sais aussi qu’il leur arrive en plusieurs rencontres que laisser dire les empêche de faire.
Sentir le mérite, et quand il est une fois connu, le bien traiter, deux grandes démarches à faire tout de suite, et dont la plupart des grands sont fort incapables.
Tu es grand, tu es puissant: ce n’est pas assez; fais que je t’estime, afin que je sois triste d’être déchu de tes bonnes grâces, ou de n’avoir pu les acquérir.
Vous dites d’un grand ou d’un homme en place qu’il est prévenant, officieux, qu’il aime à faire plaisir; et vous le confirmez par un long détail de ce qu’il a fait en une affaire où il a su que vous preniez intérêt. Je vous entends: on va pour vous au-devant de la sollicitation, vous avez du crédit, vous êtes connu du ministre, vous êtes bien avec les puissances; désiriez-vous que je susse autre chose ?
Quelqu’un vous dit: Je me plains d’un tel, il est fier depuis son élévation, il me dédaigne, il ne me connaît plus. — Je n’ai pas, pour moi, lui répondez-vous, sujet de m’en plaindre; au contraire, je m’en loue fort, et il me semble même qu’il est assez civil. Je crois encore vous entendre: vous voulez qu’on sache qu’un homme en place a de l’attention pour vous, et qu’il vous démêle dans l’antichambre entre mille honnêtes gens de qui il détourne ses yeux, de peur de tomber dans l’inconvénient de leur rendre le salut ou de leur sourire.
” Se louer de quelqu’un, se louer d’un grand “, phrase délicate dans son origine, et qui signifie sans doute se louer soi-même, en disant d’un grand tout le bien qu’il nous a fait, ou qu’il n’a pas songé à nous faire.
On loue les grands pour marquer qu’on les voit de près, rarement par estime ou par gratitude. On ne connaît pas souvent ceux que l’on loue; la vanité ou la légèreté l’emportent quelquefois sur le ressentiment: on est mal content d’eux et on les loue.
S’il est périlleux de tremper dans une affaire suspecte, il l’est encore davantage de s’y trouver complice d’un grand: il s’en tire, et vous laisse payer doublement, pour lui et pour vous.
Le prince n’a point assez de toute sa fortune pour payer une basse complaisance, si l’on en juge par tout ce que celui qu’il veut récompenser y a mis du sien; et il n’a pas trop de toute sa puissance pour le punir, s’il mesure sa vengeance au tort qu’il en a reçu.
La noblesse expose sa vie pour le salut de l’Etat et pour la gloire du souverain; le magistrat décharge le prince d’une partie du soin de juger les peuples: voilà de part et d’autre des fonctions bien sublimes et d’une merveilleuse utilité; les hommes ne sont guère capables de plus grandes choses, et je ne sais d’où la robe et l’épée ont puisé de quoi se mépriser réciproquement.
S’il est vrai qu’un grand donne plus à la fortune lorsqu’il hasarde une vie destinée à couler dans les ris, le plaisir et l’abondance, qu’un particulier qui ne risque que des jours qui sont misérables, il faut avouer aussi qu’il a un tout autre dédommagement, qui est la gloire et la haute réputation. Le soldat ne sent pas qu’il soit connu; il meurt obscur et dans la foule: il vivait de même, à la vérité, mais il vivait; et c’est l’une des sources du défaut de courage dans les conditions basses et serviles. Ceux au contraire que la naissance démêle d’avec le peuple et expose aux yeux des hommes, à leur censure et à leurs éloges, sont même capables de sortir par effort de leur tempérament, s’il ne les portait pas à la vertu; et cette disposition de cœur et d’esprit, qui passe des aïeuls par les pères dans leurs descendants, est cette bravoure si familière aux personnes nobles, et peut-être la noblesse même.
Jetez-moi dans les troupes comme un simple soldat, je suis Thersite; mettez-moi à la tête d’une armée dont j’aie à répondre à toute l’Europe, je suis Achille.
Les princes, sans autre science ni autre règle, ont un goût de comparaison: ils sont nés et élevés au milieu et comme dans le centre des meilleures choses, à quoi ils rapportent ce qu’ils lisent, ce qu’ils voient et ce qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne trop de Lulli, de Racine et de Le Brun est condamné.
Ne parler aux jeunes princes que du soin de leur rang est un excès de précaution, lorsque toute une cour met son devoir et une partie de sa politesse à les respecter, et qu’ils sont bien moins sujets à ignorer aucun des égards dus à leur naissance, qu’à confondre les personnes, et les traiter indifféremment et sans distinction des conditions et des titres. Ils ont une fierté naturelle, qu’ils retrouvent dans les occasions; il ne leur faut des leçons que pour la régler, que pour leur inspirer la bonté, l’honnêteté et l’esprit de discernement.
C’est une pure hypocrisie à un homme d’une certaine élévation de ne pas prendre d’abord le rang qui lui est dû, et que tout le monde lui cède: il ne lui coûte rien d’être modeste, de se mêler dans la multitude qui va s’ouvrir pour lui, de prendre dans une assemblée une dernière place, afin que tous l’y voient et s’empressent de l’en ôter. La modestie est d’une pratique plus amère aux hommes d’une condition ordinaire: s’ils se jettent dans la foule, on les écrase; s’ils choisissent un poste incommode, il leur demeure.
Aristarque se transporte dans la place avec un héraut et un trompette; celui-ci commence: toute la multitude accourt et se rassemble. ” Ecoutez, peuple, dit le héraut; soyez attentifs; silence, silence ! Aristarque, que vous voyez présent, doit faire demain une bonne action. ” Je dirai plus simplement et sans figure: ” Quelqu’un fait bien; veut-il faire mieux ? que je ne sache pas qu’il fait bien, ou que je ne le soupçonne pas du moins de me l’avoir appris. “
Les meilleures actions s’altèrent et s’affaiblissent par la manière dont on les fait, et laissent même douter des intentions. Celui qui protège ou qui loue la vertu pour la vertu, qui corrige ou qui blâme le vice à cause du vice, agit simplement, naturellement, sans aucun tour, sans nulle singularité, sans faste, sans affectation; il n’use point de réponses graves et sentencieuses, encore moins de traits piquants et satiriques: ce n’est jamais une scène qu’il joue pour le public, c’est un bon exemple qu’il donne, et un devoir dont il s’acquitte; il ne fournit rien aux visites des femmes, ni au cabinet, ni aux nouvellistes; il ne donne point à un homme agréable la matière d’un joli conte. Le bien qu’il vient de faire est un peu moins su, à la vérité; mais il a fait ce bien: que voudrait-il davantage ?
Les grands ne doivent point aimer les premiers temps: ils ne leur sont point favorables; il est triste pour eux d’y voir que nous sortions tous du frère et de la sœur. Les hommes composent ensemble une même famille: il n’y a que le plus ou le moins dans le degré de parenté.
Théognis est recherché dans son ajustement, et il sort paré comme une femme; il n’est pas hors de sa maison, qu’il a déjà ajusté ses yeux et son visage afin que ce soit une chose faite quand il sera dans le public, qu’il y paraisse tout concerté, que ceux qui passent le trouvent déjà gracieux et leur souriant, et que nul ne lui échappe. Marche-t-il dans les salles, il se tourne à droit, où il y a un grand monde, et à gauche, où il n’y a personne; il salue ceux qui y sont et ceux qui n’y sont pas. Il embrasse un homme qu’il trouve sous sa main, il lui presse la tête contre sa poitrine; il demande ensuite qui est celui qu’il a embrassé. Quelqu’un a besoin de lui dans une affaire qui est facile; il va le trouver, lui fait sa prière: Théognis l’écoute favorablement, il est ravi de lui être bon à quelque chose, il le conjure de faire naître des occasions de lui rendre service; et comme celui-ci insiste sur son affaire, il lui dit qu’il ne la fera point; il le prie de se mettre en sa place, il l’en fait juge. Le client sort, reconduit, caressé, confus, presque content d’être refusé.
C’est avoir une très mauvaise opinion des hommes, et néanmoins les bien connaître, que de croire dans un grand poste leur imposer par des caresses étudiées, par de longs et stériles embrassements.
Pamphile ne s’entretient pas avec les gens qu’il rencontre dans les salles ou dans les cours: si l’on en croit sa gravité et l’élévation de sa voix, il les reçoit, leur donne audience, les congédie; il a des termes tout à la fois civils et hautains, une honnêteté impérieuse et qu’il emploie sans discernement; il a une fausse grandeur qui l’abaisse, et qui embarrasse fort ceux qui sont ses amis, et qui ne veulent pas le mépriser.
Un Pamphile est plein de lui-même, ne se perd pas de vue, ne sort point de l’idée de sa grandeur, de ses alliances, de sa charge, de sa dignité; il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses pièces, s’en enveloppe pour se faire valoir; il dit: Mon ordre, mon cordon bleu; il l’étale ou il le cache par ostentation. Un Pamphile en un mot veut être grand, il croit l’être; il ne l’est pas, il est d’après un grand. Si quelquefois il sourit à un homme du dernier ordre, à un homme d’esprit, il choisit son temps si juste, qu’il n’est jamais pris sur le fait: aussi la rougeur lui monterait-elle au visage s’il était malheureusement surpris dans la moindre familiarité avec quelqu’un qui n’est ni opulent, ni puissant, ni ami d’un ministre, ni son allié, ni son domestique. Il est sévère et inexorable à qui n’a point encore fait sa fortune. Il vous aperçoit un jour dans une galerie, et il vous fuit; et le lendemain, s’il vous trouve en un endroit moins public, ou s’il est public, en la compagnie d’un grand, il prend courage, il vient à vous, et il vous dit: Vous ne faisiez pas hier semblant de nous voir. Tantôt il vous quitte brusquement pour joindre un seigneur ou un premier commis; et tantôt s’il les trouve avec vous en conversation, il vous coupe et vous les enlève. Vous l’abordez une autre fois, et il ne s’arrête pas; il se fait suivre, vous parle si haut que c’est une scène pour ceux qui passent. Aussi les Pamphiles sont-ils toujours comme sur un théâtre: gens nourris dans le faux, et qui ne haïssent rien tant que d’être naturels; vrais personnages de comédie, des Floridors, des Mondoris.
On ne tarit point sur les Pamphiles: ils sont bas et timides devant les princes et les ministres; pleins de hauteur et de confiance avec ceux qui n’ont que de la vertu; muets et embarrassés avec les savants; vifs, hardis et décisifs avec ceux qui ne savent rien. Ils parlent de guerre à un homme de robe, et de politique à un financier; ils savent l’histoire avec les femmes; ils sont poètes avec un docteur, et géomètres avec un poète. De maximes, ils ne s’en chargent pas; de principes, encore moins: ils vivent à l’aventure, poussés et entraînés par le vent de la faveur et par l’attrait des richesses. Ils n’ont point d’opinion qui soit à eux, qui leur soit propre; ils en empruntent à mesure qu’ils en ont besoin; et celui à qui ils ont recours n’est guère un homme sage, ou habile, ou vertueux: c’est un homme à la mode.
Nous avons pour les grands et pour les gens en place une jalousie stérile ou une haine impuissante, qui ne nous venge point de leur splendeur et de leur élévation, et qui ne fait qu’ajouter à notre propre misère le poids insupportable du bonheur d’autrui. Que faire contre une maladie de l’âme si invétérée et si contagieuse ? Contentons-nous de peu, et de moins encore s’il est possible; sachons perdre dans l’occasion: la recette est infaillible, et je consens à l’éprouver. J’évite par là d’apprivoiser un suisse ou de fléchir un commis; d’être repoussé à une porte par la foule innombrable de clients ou de courtisans dont la maison d’un ministre se dégorge plusieurs fois le jour; de languir dans sa salle d’audience; de lui demander en tremblant et en balbutiant une chose juste; d’essuyer sa gravité, son ris amer et son laconisme. Alors je ne le hais plus, je ne lui porte plus d’envie; il ne me fait aucune prière, je ne lui en fais pas; nous sommes égaux, si ce n’est peut-être qu’il n’est pas tranquille, et que je le suis.
Si les grands ont les occasions de nous faire du bien, ils en ont rarement la volonté; et s’ils désirent de nous faire du mal, ils n’en trouvent pas toujours les occasions. Ainsi l’on peut être trompé dans l’espèce de culte qu’on leur rend, s’il n’est fondé que sur l’espérance ou sur la crainte; et une longue vie se termine quelquefois sans qu’il arrive de dépendre d’eux pour le moindre intérêt, ou qu’on leur doive sa bonne ou sa mauvaise fortune. Nous devons les honorer, parce qu’ils sont grands et que nous sommes petits, et qu’il y en a d’autres plus petits que nous qui nous honorent.
À la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes faiblesses, mêmes petitesses, mêmes travers d’esprit, mêmes brouilleries dans les familles et entre les proches, mêmes envies, mêmes antipathies. Partout des brus et des belles-mères, des maris et des femmes, des divorces, des ruptures, et de mauvais raccommodements; partout des humeurs, des colères, des partialités, des rapports, et ce qu’on appelle de mauvais discours. Avec de bons yeux on voit sans peine la petite ville, la rue Saint-Denis, comme transportées à V** ou à F**. Ici l’on croit se haïr avec plus de fierté et de hauteur, et peut-être avec plus de dignité: on se nuit réciproquement avec plus d’habileté et de finesse; les colères sont plus éloquentes, et l’on se dit des injures plus poliment et en meilleurs termes; l’on n’y blesse point la pureté de la langue; l’on n’y offense que les hommes ou que leur réputation: tous les dehors du vice y sont spécieux; mais le fond, encore une fois, y est le même que dans les conditions les plus ravalées; tout le bas, tout le faible et tout l’indigne s’y trouvent. Ces hommes si grands ou par leur naissance, ou par leur faveur, ou par leurs dignités, ces têtes si fortes et si habiles, ces femmes si polies et si spirituelles, tous méprisent le peuple, et ils sont peuple.
Qui dit le peuple dit plus d’une chose: c’est une vaste expression, et l’on s’étonnerait de voir ce qu’elle embrasse, et jusques où elle s’étend. Il y a le peuple qui est opposé aux grands: c’est la populace et la multitude; il y a le peuple qui est opposé aux sages, aux habiles et aux vertueux: ce sont les grands comme les petits.
Les grands se gouvernent par sentiment, âmes oisives sur lesquelles tout fait d’abord une vive impression. Une chose arrive, ils en parlent trop; bientôt ils en parlent peu; ensuite ils n’en parlent plus, et ils n’en parleront plus. Action, conduite, ouvrage, événement, tout est oublié; ne leur demandez ni correction, ni prévoyance, ni réflexion, ni reconnaissance, ni récompense.
L’on se porte aux extrémités opposées à l’égard de certains personnages. La satire après leur mort court parmi le peuple, pendant que les voûtes des temples retentissent de leurs éloges. Ils ne méritent quelquefois ni libelles ni discours funèbres; quelquefois aussi ils sont dignes de tous les deux.
L’on doit se taire sur les puissants: il y a presque toujours de la flatterie à en dire du bien; il y a du péril à en dire du mal pendant qu’ils vivent, et de la lâcheté quand ils sont morts. Du souverain
Les Caractères ou les Moeurs de ce siècle par Jean de La Bruyère
 Cultivons nous
Cultivons nous