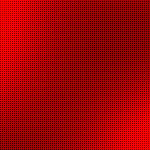Chapitre XXXV
Vendredi 21 août. — Le lendemain le magnifique geyser a disparu. Le vent a fraîchi, et nous a rapidement éloignés de l’îlot Axel. Les mugissements se sont éteints peu à peu.
Le temps, s’il est permis de s’exprimer ainsi, va changer avant peu. L’atmosphère se charge de vapeurs, qui emportent avec elles l’électricité formée par l’évaporation des eaux salines; les nuages s’abaissent sensiblement et prennent une teinte uniformément olivâtre; les rayons électriques peuvent à peine percer cet opaque rideau baissé sur le théâtre où va se jouer le drame des tempêtes.
Je me sens particulièrement impressionné, comme l’est sur terre toute créature à l’approche d’un cataclysme. Les “ cumulus ” entassés dans le sud présentent un aspect sinistre; ils ont cette apparence “ impitoyable ” que j’ai souvent remarquée au début des orages. L’air est lourd, la mer est calme.
Au loin les nuages ressemblent à de grosses balles de coton amoncelées dans un pittoresque désordre; peu à peu ils se gonflent et perdent en nombre ce qu’ils gagnent en grandeur; leur pesanteur est telle qu’ils ne peuvent se détacher de l’horizon; mais, au souffle des courants élevés, ils se fondent peu à peu, s’assombrissent et présentent bientôt une couche unique d’un aspect redoutable: parfois une pelote de vapeurs, encore éclairée, rebondit sur ce tapis grisâtre et va se perdre bientôt dans la masse opaque.
Évidemment l’atmosphère est saturée de fluide; j’en suis tout imprégné; mes cheveux se dressent sur ma tète comme aux abords d’une machine électrique. Il me semble que, si mes compagnons me touchaient en ce moment, ils recevraient une commotion violente.
À dix heures du matin, les symptômes de l’orage sont plus décisifs; on dirait que le vent mollit pour mieux reprendre haleine; la nue ressemble à une outre immense dans laquelle s’accumulent les ouragans.
Je ne veux pas croire aux menaces du ciel, et cependant je ne puis m’empêcher de dire:
” Voilà du mauvais temps qui se prépare. ”
Le professeur ne répond pas. Il est d’une humeur massacrante, à voir l’océan se prolonger indéfiniment devant ses yeux. Il hausse les épaules à mes paroles.
” Nous aurons de l’orage, dis-je en étendant la main vers l’horizon, ces nuages s’abaissent sur la mer comme pour l’écraser ! ”
Silence général. Le vent se tait. La nature a l’air d’une morte et ne respire plus. Sur le mat, où je vois déjà poindre un léger feu Saint-Elme, la voile détendue tombe en plis lourds. Le radeau est immobile au milieu d’une mer épaisse et sans ondulations. Mais, si nous ne marchons plus, à quoi bon conserver cette toile, qui peut nous mettre en perdition au premier choc de la tempête ?
” Amenons-la, dis-je, abattons notre mât ! Cela sera prudent !
— Non, par le diable ! s’écrie mon oncle, cent fois non ! Que le vent nous saisisse ! que l’orage nous emporte ! mais que j’aperçoive enfin les rochers rivage, quand notre radeau devrait s’y briser en mille pièces ! ”
Ces paroles ne sont pas achevées que l’horizon du sud change subitement d’aspect. Les vapeurs accumulées se résolvent en eau, et l’air, violemment appelé pour combler les vides produits par la condensation, se fait ouragan. Il vient des extrémités les plus reculées de la caverne. L’obscurité redouble. C’est à peine si je puis prendre quelques notes incomplètes.
Le radeau se soulève, il bondit. Mon oncle est jeté de son haut. Je me traîne jusqu’à lui. Il s’est fortement cramponné à un bout de câble et parait considérer avec plaisir ce spectacle des éléments déchaînés.
Hans ne bouge pas. Ses longs cheveux, repoussés par l’ouragan et ramenés sur sa face immobile, lui donnent une étrange physionomie, car chacune de leurs extrémités est hérissée de petites aigrettes lumineuses. Son masque effrayant est celui d’un homme antédiluvien, contemporain des ichthyosaures et des megatherium.
Cependant le mât résiste. La voile se tend comme une bulle prête à crever. Le radeau file avec un emportement que je ne puis estimer, mais moins vite encore que ces gouttes d’eau déplacées sous lui, dont la rapidité fait des lignes droites et nettes.
” La voile ! la voile ! dis-je, en faisant signe de l’abaisser.
— Non ! répond mon oncle.
— Nej, ” fait Hans en remuant doucement la tête.
Cependant la pluie forme une cataracte mugissante devant cet horizon vers lequel nous courons en insensés. Mais avant qu’elle n’arrive jusqu’à nous le voile de nuage se déchire, la mer entre en ébullition et l’électricité, produite par une vaste action chimique qui s’opère dans les couches supérieures, est mise en jeu. Aux éclats du tonnerre se mêlent les jets étincelants de la foudre; des éclairs sans nombre s’entre-croisent au milieu des détonations; la masse des vapeurs devient incandescente; les grêlons qui frappent le métal de nos outils ou de nos armes se font lumineux; les vagues soulevées semblent être autant de mamelons ignivomes sous lesquels couve un feu intérieur, et dont chaque crête est empanachée d’une flamme.
Mes yeux sont éblouis par l’intensité de la lumière, mes oreilles brisées par le fracas de la foudre ! Il faut me retenir au mât, qui plie comme un roseau sous la violence de l’ouragan ! ! !
Ici mes notes de voyage devinrent très-incomplètes. Je n’ai plus retrouvé que quelques observations fugitives, prises machinalement pour ainsi dire. Mais, dans leur brièveté, dans leur obscurité même, elles sont empreintes de l’émotion qui me dominait, et mieux que ma mémoire elles me donnent le sentiment de notre situation.
Dimanche 23 août. — Où sommes-nous ? Emportés avec une incomparable rapidité.
La nuit a été épouvantable. L’orage ne se calme pas. Nous vivons dans un milieu de bruit, une détonation incessante. Nos oreilles saignent. On ne peut échanger une parole.
Les éclairs ne discontinuent pas. Je vois des zigzags rétrogrades qui, après un jet rapide, reviennent de bas ou haut et vont frapper la voûte de granit. Si elle allait s’écrouler ! D’autres éclairs se bifurquent ou prennent la forme de globes de feu qui éclatent comme des bombes. Le bruit général ne parait pas s’en accroître; il a dépassé la limite d’intensité que peut percevoir l’oreille humaine, et, quand toutes les poudrières du monde viendraient à sauter ensemble, nous ne saurions en entendre davantage. ”
Il y a émission continue de lumière à la surface des nuages; la matière électrique se dégage incessamment de leurs molécules; évidemment les principes gazeux de l’air sont altérés; des colonnes d’eau innombrables s’élancent dans l’atmosphère et retombent en écumant.
Où allons-nous ?… Mon oncle est couché tout de son long à l’extrémité du radeau. La chaleur redouble. Je regarde le thermomètre; il indique…
Lundi 24 août. — Cela ne finira pas ! Pourquoi l’état de cette atmosphère si dense, une fois modifié, ne serait-il pas définitif ?
Nous sommes brisés de fatigue. Hans comme à l’ordinaire. Le radeau court invariablement vers le sud-est. Nous avons fait plus de deux cents lieues depuis l’îlot Axel.
À midi la violence de l’ouragan redouble. Il faut lier solidement tout les objets composant la cargaison. Chacun de nous s’attache également. Les flots passent par-dessus notre tête.
Impossible de s’adresser une seule parole depuis trois jours. Nous ouvrons la bouche, nous remuons nos lèvres; il ne se produit aucun son appréciable. Même en se parlant à l’oreille on ne peut s’entendre.
Mon oncle s’est approché de moi. Il a articulé quelques paroles. Je crois qu’il m’a dit: “ Nous sommes perdus. ” Je n’en suis pas certain.
Je prends le parti de lui écrire ces mots: “ Amenons notre voile. ”
Il me fait signe qu’il y consent.
Sa tête n’a pas eu le temps de se relever de bas en haut qu’un disque de feu apparaît au bord du radeau. Le mât et la voile sont partis tout d’un bloc, et je les ai vus s’enlever à une prodigieuse hauteur, semblables au ptérodactyle, cet oiseau fantastique des premiers siècles.
Nous sommes glacés d’effroi. La boule mi-partie blanche, mi-partie azurée, de la grosseur d’une bombe de dix pouces, se promène lentement, en tournant avec une surprenante vitesse sous la lanière de l’ouragan. Elle vient ici, là, monte sur un des bâtis du radeau, saute sur le sac aux provisions, redescend légèrement, bondit, effleure la caisse à poudre. Horreur ! Nous allons sauter ! Non ! Le disque éblouissant s’écarte; il s’approche de Hans, qui le regarde fixement; de mon oncle, qui se précipite à genoux pour l’éviter; de moi, pâle et frissonnant sous l’éclat de la lumière et de la chaleur; il pirouette près de mon pied, que j’essaye de retirer. Je ne puis y parvenir.
Une odeur de gaz nitreux remplit l’atmosphère; elle pénètre le gosier, les poumons. On étouffe.
Pourquoi ne puis-je retirer mon pied ? Il est donc rivé au radeau ! Ah ! la chute de ce globe électrique a aimanté tout le fer du bord; les instruments, les outils, les armes s’agitent en se heurtant avec un cliquetis aigu; les clous de ma chaussure adhèrent violemment à une plaque de fer incrustée dans le bois. Je ne puis retirer mon pied !
Enfin, par un violent, effort, je l’arrache au moment où la boule allait le saisir dans son mouvement giratoire et m’entraîner moi-même, si…
Ah ! quelle lumière intense ! le globe éclate ! nous sommes couverts par des jets de flammes !
Puis tout s’éteint. J’ai eu le temps de voir mon oncle étendu sur le radeau. Hans toujours à sa barre et “ crachant du feu ” sous l’influence de l’électricité qui le pénètre !
Où allons-nous ? où allons-nous ?
Mardi 25 août. — Je sors d’un évanouissement prolongé; l’orage continue; les éclairs se déchaînent comme une couvée de serpents lâchée dans l’atmosphère.
Sommes-nous toujours sur la mer ? Oui, et emportés avec une vitesse incalculable. Nous avons passé sous l’Angleterre, sous la Manche, sous la France, sous l’Europe entière, peut-être !
Un bruit nouveau se fait entendre ! Évidemment, la mer qui se brise sur des rochers !….. Mais alors…
Voyage au centre de la Terre
Un roman de Jules Verne
 Cultivons nous
Cultivons nous